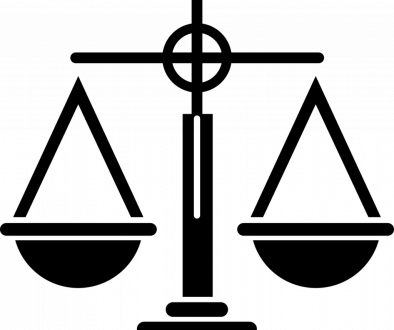La dignité du patient
«La dignité du patient en psychiatrie hospitalisé sans consentement». Par François Jacquot, Avocat.
Article paru en février 2020 sur www.village-justice.com
A lire en ligne ici : https://www.village-justice.com/articles/dignite-patient-psychiatrie-hospitalise-sans-consentement,33862.html
LA DIGNITE DU PATIENT EN PSYCHIATRIE HOSPITALISE
SANS CONSENTEMENT
Cet article a pour vocation d’informer le grand public et non de disserter de manière savante sur le concept de dignité appliqué aux patients hospitalisés sans consentement.
La dignité a plusieurs définitions courantes et aucune véritable définition juridique.
Dans son sens ordinaire le plus large, le mot signifie « le Respect que mérite quelqu’un ou quelque chose ». Le dictionnaire évoque plus précisément «le prestige inaliénable dont jouit une personne en raison de son comportement, ou qui sont attachés à une chose, et qui leur valent considération et respect ou y donnent droit», illustrant cette définition avec l’exemple de «La dignité de la personne humaine»1.
L’étymologie latine provient de « dignitas », « decere » : « convenir, être convenable». L’origine grecque du mot dignité est axios : « ce qui est convenable, ce qui vaut, ce qui mérite ».
Avant les atrocités de la seconde guerre mondiale, le droit n’évoquait que très peu la dignité humaine. Mais la conscience collective a été bouleversée par les crimes nazis au point de devoir rappeler dans des textes juridiques ce qui, pourtant, relève de l’évidence depuis que l’Homme est Homme.
Ainsi, sur un plan international, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (ONU, 1948) semble être le premier texte, certes non contraignant, à proclamer cette valeur dès les premières lignes de son préambule :
« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression ».
En conséquence, la Déclaration Universelle prévoit que le premier des droits de l’Homme est que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».
Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques adopté le 16 décembre 1966 (entré en vigueur le 23 mars 1976), dont le respect s’impose en France en raison de son caractère obligatoire, apporte des précisions cruciales dans son préambule. Ce dernier prévoit que « conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde », en ajoutant que «ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine ».
Au plan du droit communautaire, le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, signée lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000(12) dispose que « consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l’État de droit ». Le Chapitre I de la Charte est ainsi consacré à la dignité. De son côté, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que le « droit fondamental à la dignité humaine et à l’intégrité de la personne» est un principe général du droit communautaire dont le respect est, à ce titre, une condition de légalité des actes communautaires ».2
La dignité humaine est donc au centre de tout le droit international.
Par ailleurs, même si en droit constitutionnel français elle ne figure dans aucun texte, le Conseil Constitutionnel l’a déduite du Préambule de la Constitution de 1946 qui «réaffirme que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation » et considère qu’elle « constitue un principe à valeur
constitutionnelle ».
Pour résumer, la dignité humaine est le respect dû à toute personne appartenant au genre humain, et qui, de ce fait, lui confère une protection juridique spéciale à travers des droits fondamentaux. Dans le lexique juridique, elle est définie comme la «valeur infinie de la personne humaine qui commande de la traiter toujours d’abord comme une fin et jamais comme un simple moyen. C’est l’attribut fondamental de la personnalité humaine qui la fonde à la fois comme sujet moral et sujet de droit».
Ainsi, parce que l’Homme est Homme et non objet ou animal, il jouit d’une considération, d’un respect et d’une protection juridique qui sont sans équivalents.
Certes, les autres formes de vie méritent également considération et jouissent d’une certaine protection juridique ; mais seul l’être humain, en raison de sa primauté sur toute autre forme de vie, bénéfice d’une absolue protection de sa dignité.
Nous n’entrerons pas plus dans les détails du droit français au su et du principe de la dignité qui recouvre de nombreuses applications car nous allons nous attacher à exposer l’application de ce principe en droit médical, dans le cas des patients en psychiatrie hospitalisés sans consentement.
I- DIGNITÉ ET PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET
PSYCHIQUE DU PATIENT
En France, la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 « relative au respect du corps humain» et la loi n°94-654 du 29 juillet 1994 « relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal », ont introduit dans le code civil les principes dégagés par le droit international. En particulier, les articles 16 à 16-3 du code civil issus de ces lois, prévoient que :
« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».
« Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. » (Art. 16-1).
« Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci (L.no 2008-1350 du 19 déc. 2008, art. 12) «, y compris après la mort» ».
(Art. 16-2)
Peu de temps après l’adoption de ces lois françaises, le 4 avril 1997, les États du Conseil de l’Europe ont adopté la Convention internationale « pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine » dite « Convention d’Oviodo ». Il s’agit du premier traité international contraignant pour la protection de la dignité humaine en matière médicale.
La France ne l’a ratifié que le 13 décembre 2011 et il n’est entré en vigueur dans notre pays que le 1er avril 2012.
Comme souvent, le Préambule énonce les raisons de l’adoption du traité. En l’espèce, il met l’accent « la nécessité de respecter l’être humain à la fois comme individu et dans son appartenance à l’espèce humaine » et sur « l’importance d’assurer sa dignité », étant précisé que certains actes « pourraient mettre en danger la dignité humaine par un usage impropre de la biologie et de la médecine ».
Les articles 1 et 2 prévoient les mêmes règles que celle du code civil français :
– « Article 1 – Objet et finalité
Les Parties à la présente Convention protègent l’être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.
Chaque Partie prend dans son droit interne les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.
– Article 2 – Primauté de l’être humain
« L’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science ».
Dans le code de la santé publique, il est également affirmé que « la personne malade a droit au respect de sa dignité » (Art. L. 1110-2 CSP).
La protection de l’individu passe donc avec celle de la société et avant l’intérêt scientifique, le texte de cette convention étant, à cet égard, sans aucune nuance et ne contenant pas d’exceptions ou de limites.
A- LA NÉCESSITÉ DU TRAITEMENT PSYCHIATRIQUE
Pour ce qui concerne la « Protection des personnes souffrant d’un trouble mental », l’article 7 de la Convention d’Oviodo prévoit que :
« La personne qui souffre d’un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l’absence d’un tel traitement risque d’être gravement préjudiciable à sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues par la loi comprenant des procédures de surveillance et de contrôle ainsi que des voies de recours ».
De son côté, le code civil reprend la même règle :
« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de
nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt
thérapeutique d’autrui » (Art. 16-3, L.no2004-800 du 6 août 2004, art. 9).
Or, la première chose qui interpelle à ce su et est qu’à partir du moment où une personne est considérée comme souffrant de troubles mentaux et placée en hospitalisation sans consentement, aucune investigation médicale n’est réalisée pour connaître la cause de ses troubles. Le code de la santé publique ne prévoit qu’un simple « examen somatique ».
La personne hospitalisée est immédiatement soumise à toute la batterie de la pharmacopée chimique : psychotropes, antidépresseurs, anxiolytiques, etc, sans compter les électrochocs ou l’isolement et la contention dont nul ne peut nier qu’ils sont invasifs et qu’ils produisent des nombreux effets secondaires indésirables, outre leur caractère attentatoire à l’intégrité physique et psychique.Pourtant, il est scientifiquement démontré qu’un problème d’ordre physique ou qu’une carence nutritionnelle peuvent tous deux générer de sérieux troubles mentaux.
Les études scientifiques récentes mettent en exergue l’importance des nutriments pour le bien être mental, comme le souligne M. Jérôme Sarris, Professeur de psychiatrie à l’Université de Melbourne. Ce dernier écrit qu’un « corpus de recherche de plus en plus solide met en évidence les effets néfastes des régimes alimentaires malsains et des carences en nutriments, ainsi que la valeur protectrice des régimes sains – ainsi que certains suppléments nutritionnels au besoin – pour maintenir et promouvoir la santé mentale ». Selon lui, « la littérature de recherche suggère que l’amélioration de l’alimentation et les interventions nutritionnelles peuvent aider à réduire le risque, voire arrêter la progression, de certains troubles psychiatriques. Les études cliniques soutiennent l’utilisation de certains nutriments, qui influencent une gamme d’activités neurochimiques bénéfiques pour le traitement des troubles mentaux, comme suppléments médicinaux ».3
Aussi curieux que cela paraisse être, des études scientifiques très sérieuses démontrent que les causes de certaines maladies mentales peuvent être purement nutritionnelles et que les nutriments peuvent constituer une bonne thérapie à ce su et ! Il est par exemple indiqué que la déficience en magnésium peut être corrélée à des symptômes dépressifs et d’anxiété.4
Ainsi, avant d’être soumis à des traitements chimiques très lourds, voire à des électrochocs, le patient en psychiatrie devrait avoir le droit de bénéficier, comme tout
malade, d’examens médicaux dignes de ce nom pour déterminer les causes de sa maladie.
Tel n’est pas le cas en pratique car le ou les psychiatres qui décident de l’hospitalisation et du traitement ne se fondent que sur les symptômes visibles de désordre mental mais n’en recherche nullement les causes. Ils appliquent systématiquement un protocole médical de type standardisé très intrusif pour le patient et qui induit de nombreux effets secondaires nocifs.
Pourtant, le principe de la nécessité du traitement est fondamental et il incombe à l’autorité médicale de justifier cette nécessité eu égard à d’autres thérapeutiques qui pourraient s’avérer meilleures et moins dangereuses.
B- LE PRINCIPE DU CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET BÉNÉFIQUE DU TRAITEMENT
PSYCHIATRIQUE
L’une des principales règles de la Convention d’Oviedo est qu’ « une intervention ne peut être effectuée sur une personne n’ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct », sauf dans le cas des dons d’organes ou celui des recherches médicales qui relèvent de règles particulières.
Les principes édictés par le code de la santé publique issus des traités internationaux, sont également très clairs en la matière :
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir (L.no 2016-87 du 2 févr. 2016, art. 1er-I-1o
-a) «, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire (L.no 2016-87 du 2 févr. 2016, art. 1er-I-1o -a).(…)
Les actes de prévention, d’investigation ou (L. no 2016-87 du 2 févr. 2016, art. 1er-I-1o -b) «de traitements et» de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (L. no 2016-87 du 2 févr. 2016, art. 1er-I-1o -c et 2o ) (Art. L. 1110-5 CSP)Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherché » (Art. L. 3211-3 CSP).
De même, il existe de nombreuses règles du code de déontologie médicale français qui abondent dans ce sens. Ainsi, « le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité » (Art.R. 4127-2 CSP).
Il soigne librement mais « compte tenu des données acquises de la science » (Art. R. 4127-8 CSP). C’est la raison pour laquelle « tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu » (Art.
R. 4127-11 CSP).
Il doit au patient « des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science » (Art. R. 4127-32 CSP). Lorsqu’il diagnostique, il est tenu de le faire « avec le plus grand soin » et « en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés » (Art. R. 4127-33 CSP).
Le praticien doit « limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles » (Art. R. 4127-8 CSP).
Il ne peut « proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite » (Art. R. 4127-39 CSP).
Enfin, « le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » (Art. R.4127-39 CSP).
De cela il résulte que tout traitement doit être scientifiquement validé ; qu’il doit être strictement nécessaire à l’efficacité des soins et qu’il faut qu’il procure un maximum de sécurité au patient, avec un minimum d’inconvénients.
Cela pose la question cruciale de ce qui peut être considéré comme un « bénéfice direct » découlant du traitement, en particulier lors d’une hospitalisation sans consentement puisque, logiquement, un malade devrait pouvoir questionner tout traitement intrusif qui ne lui apporte aucun bénéfice médicalement prouvé, qui empire sa situation, ou qui provoque des effets secondaires particulièrement indésirables.
En effet, la loi donne au malade le droit de vérifier le caractère scientifique de la thérapeutique qui lui est administrée, d’apprécier si les risques qu’elle lui fait encourir sont proportionnés eu égard au bénéfice attendu, et il devrait donc pouvoir s’opposer à un traitement qui porte atteinte à sa dignité ou qui entrave de manière sérieuse ses libertés fondamentales, notamment celle d’aller et venir. A défaut, les grands principes
de la loi seraient lettre morte.
Or, si l’on peut facilement apprécier le bénéfice d’une chirurgie ou d’un traitement médicamenteux ordinaire parce qu’il guérit le malade, le place en rémission ou le soulage, quel est le critère qui détermine ce qui est bénéfique dans un traitement chimique de type psychiatrique, voire dans l’utilisation de l’électrochoc
(sismothérapie) ? Le patient a-t-il été correctement informé des études récentes qui révèlent que les personnes suivies pour des troubles psychiques sévères ont une
« espérance de vie fortement réduite et une mortalité quadruplée » ? 5
A-t-il été en mesure d’apprécier si la réduction de son espérance de vie et l’augmentation considérable du taux de mortalité sont ou non corrélées à la lourdeur des traitements psychiatriques et s’il y avait d’autres alternatives ?
Si l’on prend également l’exemple du patient qui a été placé à l’isolement avec ou sans contention, on doit pouvoir être en mesure de connaître le caractère scientifique de ces mesures et leur véritable bénéfice médical direct.
A cet égard, en jugeant récemment « qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la mise en œuvre d’une mesure » telle que l’isolement ou la contention du fait qu’elle serait de nature « médicale »6 la plus haute juridiction judiciaire s’est inclinée devant la toute puissance de l’autorité médicale, laissant à cette dernière la faculté d’enfermer et d’attacher les malades sans que l’autorité judiciaire, pourtant garante de la liberté individuelle (art.66 Constitution française), n’assure le moindre contrôle.
Cette décision constitue un recul très sérieux des libertés fondamentales qui est d’autant plus surprenant que le caractère médical de l’isolement ou de contention est très contestable et qu’en pratique, les hôpitaux autorisent des durées d’isolement et de contention très longues et manifestement non conformes à la loi.
Dans son rapport de 1998, l’ANAES (aujourd’hui la Haute autorité de la santé) s’interrogeait dé à sur le caractère thérapeutique de telles mesures, y voyant plutôt « un moyen pour la mise en œuvre de soins » tout en faisant état « des pratiques gravement attentatoires aux droits fondamentaux dont l’efficacité thérapeutique n’est pas prouvé ».7
Il existe à ce su et une importante littérature de la part d’organismes internationaux de protection des droits de l’Homme tels que l’ONU, le Comité pour la Prévention de la Torture et des peines et traitements inhumains et dégradants (CTP). En France, le contrôleur des lieux de privation de liberté (CGLPL) a également écrit des rapports à ce sujet. Tous évoquent des « mesures de contraintes physiques » plutôt que des actes médicaux.8
La loi de 2016 est venue encadrer l’isolement en posant comme règle dans l’article L.3222-5-1 du code de santé publique qu’ « il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui », ceci « pour une durée limitée » et comme « pratiques de dernier recours ».
On note que la loi elle-même qualifie l’isolement et la contention de « pratiques » et non d’actes médicaux, même si ces mesures sont décidées par un médecin. Il s’agit donc d’actes ayant avant tout pour objet la protection qui, du fait de leur nature sécuritaire, ne peuvent être mise en œuvre que dans des circonstances exceptionnelles. Même à supposer qu’il s’agisse d’actes médicaux, ils sont par nature contraires à la dignité humaine et portent très sérieusement atteinte à la liberté d’aller et venir. Par conséquent, le patient doit être protégé contre les excès de ces pratiques hospitalières et devrait être en droit de s’adresser au juge pour obtenir leur cessation immédiate en cas de besoin. Or, comment un patient peut-il contester le bénéfice d’un « traitement » psychiatrique qui conduit à des mesures gravement attentatoires à ses libertés fondamentales, voire, comme c’est le cas de l’isolement et de la contention, à des traitements parfois qualifiés de dégradants, humiliants, indignes, ou même dangereux, si l’autorité judiciaire elle-même considère qu’il appartient au seul médecin de décider 9 et ce, bien que « les personnes qui les subissent sont dans un état de fragilité et de dépendance qui ne leur permet pas de se défendre » ?
Même la communauté médicale s’interroge sur la nature médicale de l’isolement et de la contention et certains psychiatres n’hésitent pas à présenter des « Arguments cliniques pour ne pas isoler et/ou attacher un patient » en confirmant que « les mesures coercitives collectives en psychiatrie ont d’abord une connotation pénale qui n’a rien à voir avec notre exercice médical ».10
De toute évidence, l’autorité judiciaire a le devoir de contrôler la nécessité et l’efficacité de ces mesures prétendument thérapeutiques compte tenu de l’atteinte à la dignité et à la liberté que les malades subissent, sans compter les dommages psychiques et physiques qui en résultent. 8
Mais, les règles évoquées plus haut, toutes édictées dans l’intérêt supérieur de la personne humaine, fut-elle privée de ses facultés mentales, sont largement battues en brèche lorsqu’il s’agit d’hospitalisation complète sans consentement. Trop souvent dépassée par l’autorité médicale qui affiche des certitudes absolues, voire
quasi dogmatiques, la justice se laisse trop facilement convaincre du bien fondé de l’hospitalisation sans consentement et de sa prolongation, de même que de la qualité des traitements prodigués et de leur efficacité.
Pourtant, la loi et le droit international sont très clairs au su et des droits fondamentaux dont jouissent les patients hospitalisés sans consentement. La Cour européenne des droits de l’Homme assure un contrôle au titre du droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants (art.3 CEDH) ainsi qu’au nom de la protection de la vie privée (art.8 CEDH).
Dans ce cadre, elle considère qu’ « une intervention médicale effectuée contre la volonté d’une personne s’analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, et plus particulièrement à son intégrité physique ».11
De même, selon sa jurisprudence, « l’administration forcée de médicaments constitue une grave atteinte à l’intégrité physique d’une personne».
Elle en tire deux importantes conséquences. D’une part, « la nécessité médicale » de l’acte doit être démontrée « de manière convaincante ». D’autre part, la décision ne saurait être laissée « dans les mains des seuls médecins traitants ». Au contraire, la Cour européenne a clairement jugé qu’une telle décision de forcer le traitement doit être soumise à un « contrôle judiciaire immédiat ». Or, dans l’affaire ici évoquée, la « requérante ne disposait d’aucun recours lui permettant de demander à un tribunal de statuer sur la régularité de l’administration forcée de médicaments, y compris sa proportionnalité, ou d’en ordonner la cessation ».12
En totale contradiction avec l’arrêt récent rendu par la Cour de cassation qualifiant l’isolement et la contention d’actes médicaux échappant au contrôle du juge, cette jurisprudence salutaire de la Cour européenne invite à repenser le rôle du juge, et celui des autres acteurs de la justice.
Face à l’autorité médicale, il est indispensable qu’il y ait une véritable autorité judiciaire capable de remettre en cause la nécessité des soins prodigués, leur proportionnalité, leur dangerosité, leur bénéfice risque, et même jusqu’à leur opportunité.
Il est donc nécessaire de profondément changer la culture à la fois sociale et juridique qui place le médecin en position d’autorité toute puissante et de remettre au centre des débats l’humanité du patient et ses droits fondamentaux, en premier lieu celui d’obtenir le meilleur traitement possible, le tout sous contrôle du juge.
Pour ce faire, il est également indispensable que les avocats soient formés pour être capables de faire valoir auprès des juges les dernières études scientifiques au su et des meilleures et plus innovantes thérapeutiques au bénéfice de leurs patients.
De même, la magistrature doit être mieux formée afin d’être réellement indépendante face à l’autorité médicale.
II- LE CONSENTEMENT AU TRAITEMENT PSYCHIATRIQUE
Il va de soi que l’un des corolaires de la dignité humaine est la protection de l’intégrité physique et psychique de la personne humaine et que seul l’individu est en principe en droit d’autoriser une intrusion dans cette sphère.
Ce principe est affirmé à la fois sur le plan international, en droit civil français, en droit médical et en droit déontologique.
Ainsi, l’article 5 de la Convention d’ Oviedo ne pose en règle générale qu’une «intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé ». Cet article 5 évoque le « consentement libre et éclairé » qui doit découler d’une « information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques » donnée préalablement au
patient.
La loi française pose aujourd’hui comme règle générale que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé » (Art. L. 1111 2, al. 1 ‐er CSP) et que « seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser » (Art. L. 1111 2, al. 4). ‐
A- Le malade doit être informé et associé au traitement
L’article 6 de la Convention d’Oviedo concernant le «Protection des personnes n’ayant
pas la capacité de consentir», aménage la règle de l’article 5 ci-dessus évoqué :
«3. Lorsque, selon la loi, un majeur n’a pas, en raison d’un handicap mental, d’une maladie ou pour un motif similaire, la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi.
La personne concernée doit dans la mesure du possible être associée à la procédure d’autorisation.
4. Le représentant, l’autorité, la personne ou l’instance mentionnés aux paragraphes 2 et 3 reçoivent, dans les mêmes conditions, l’information visée à
l’article 5.5. L’autorisation visée aux paragraphes 2 et 3 peut, à tout moment, être retirée dans l’intérêt de la personne concernée ».
Ainsi, une personne qui n’a pas la capacité de consentir au traitement psychiatrique lui étant administré lors d’une hospitalisation sans consentement, devrait, dans la mesure du possible, être consultée et associée au protocole de soins. S’agissant de l’hospitalisation sans consentement, l’article L.3211-3 du CSP indique
clairement que la personne « est informée : a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) (…) L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible ».
L’article L.1111-2 du CSP dispose à ce su et que « cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel » et qu’elle «porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».
Ce droit est trop peu utilisé car les patients ne sont pas souvent en état de l’exercer. En position de nette infériorité face à l’autorité médicale, souvent affaiblis et désorientés par leur mal être, leur hospitalisation contrainte est un cercle vicieux : présumés incapables de donner leur consentement, ils sont peu sollicités par l’équipe médicale et, lorsqu’ils le sont et qu’ils refusent le traitement, ce dernier leur est administré de force, sans délais et sans consultation préalable de la personne de confiance.
Pourtant, le droit au consentement est loin d’être lettre morte dans le cas de l’hospitalisation contrainte. En effet, la Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt récent,
vient de rappeler que « l’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible ». Dans ce dossier, après avoir constaté que « l’analyse des pièces ne démontre pas que Madame Andrée X… a été régulièrement informée au sens de l’article L.3211-3 susvisé, dès lors que les accusés de réception attestant du respect des formalités légales sont systématiquement vierges, tant au moment de la décision d’admission en date du 15 décembre 2017 que de la décision de prolongation d’hospitalisation complète en date du 18 décembre suivant », la Cour a considéré que « les
conditions de l’hospitalisation complète n’étant pas réunies » et a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.13
B- LE DROIT D’INTERVENTION DES TIERS EN FAVEUR DU PATIENT HOSPITALISÉ
SOUS CONTRAINTE
Par ailleurs, la loi a mis en application les principes de l’article 5 de la Convention d’Oviedo qui oblige les États, lorsque le majeur est incapable de consentir à une
intervention médicale, à obtenir « l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi ».
En premier lieu, le droit français a institué la personne de confiance.
Aux termes de l’article L1111-6 du CSP, « un parent, un proche ou le médecin traitant » peut être désigné comme personne de confiance, laquelle « sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage ».
D’un point de vue déontologique, l’article R.4127-36 du CSP dispose que « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas » et que « si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité ».
La loi prévoit également que « si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation ».
Autrement dit, aucun traitement psychiatrique en milieu hospitalier ne peut être administré sans que la personne de confiance n’ait été informée et que le médecin ait recueilli son avis si le patient n’est pas du tout en état de l’exprimer ou si ce dernier a souhaité être accompagné.Pour rendre ces droits effectifs, il est prévu que « lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé (…), il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en dispose autrement » (art. L1111-6 du CSP). Mais, en pratique, le rôle des tiers est très peu favorisé, bien qu’il soit capital pour la préservation des droits et intérêts du patient hospitalisé sans consentement. Un patient qui a été soumis à de nombreuses séances d’électrochoc, ou qui absorbe des doses massives de psychotropes, est trop shooté pour pouvoir manifester un
consentement ou pour donner simplement son avis.
Il est donc capital que la personne de confiance soit active ainsi que les proches.
En second lieu, dans le cas d’un recours à la procédure de péril imminent, la loi française prévoit également que le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, ou à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci (Art. L 3212-1 II 2o alinéa 2 du CSP).
La jurisprudence ne sanctionne là encore que trop rarement le manquement à cette obligation. On trouve cependant trace de quelques décisions encourageantes telles que celle de la Cour d’appel de Caen qui a ordonné la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation sans consentement car il ne résultait « d’aucun élément du dossier qu’une information a été donnée à la famille » du patient au su et « de l’hospitalisation de cette dernière en soins psychiatriques pour péril imminent de telle sorte qu’il convient de constater que la procédure est irrégulière, d’infirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 9 mars 2017 et d’ordonner la main levée immédiate de la mesure de soins sans consentement ».14
***
Le monde hospitalisé est un microcosme marqué par la toute puissance de l’autorité médicale, un monde qui est réfractaire au contrôle du patient ou de la justice. Aussi, l’effectivité du respect de la dignité du patient hospitalisé sous contrainte est-elle avant tout une affaire connaissance et de mise en pratique des nombreux droits que la loi française confrère au patient.
_________________________________________________________________
1 https://www.cnrtl.fr/defnition/dignité.
2 CJCE 9 oct. 2001, Pays-Bas c/ Parlement et Conseil, aff. C-377/98, Rec. CJCE 2001, p. I-7079 ; D. 2002. 2925.
V. aussi, CJCE 14 oct. 2004, Omega Spielhallen-und Automatenaufstellungs-GmbH c/ Oberbürgermeisterin der
Bundesstadt Bonn, aff. C-36/02, AJDA 2005. 152, note Von Walter, Dr. adm., janv. 2005, n° 11, note Cassia.
3 https://the conversation.com/health-check-seven-nutriments-important-for-mental-health-and-where-
to-fnd-them-37170.
4 Association beetween magnésium intake and depression and anxiety in community-dwelling adults : the
Hordaland Health Study, publiée par Aus N J Psychiatry, 2009, Jan 43 (1) :45-52, https://ncbi.nim.nih-
gov/pubmed/19085527.
5 https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/237-personnes-suivies-pour-des-troubles-psychiques-severes-une-esperance-de-vie-fortement-reduite.pdf: « Personnes suivies pour troubles psychiques sévères : une espérance de vie fortement réduite et une mortalité prématurée quadruplée », par Magali Coldefy Gandré (IRDRES)
6 Cour de cassation, 7 novembre 2019, n°19-18262.
7 ANAES ; « Évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé. L’audit clinique
appliqué à l’utilisation des chambres d’isolement en psychiatrie », rapport de juin 1998, pages 12-13.
8 Isolement et contention des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques : « Vol au dessus d’un nid
de coucou », par François Jacquot, sur www.village- justice.com.
9 CGLPl, rapport « Isolement et contention dans les établissements de santé mentale », 14 avril 2016.
10 www.ch-la-chartreuse-dijon-cotedor/fr : « Alternatives pour restreindre l’isolement et la contention.
Arguments cliniques pour ne pas isoler et/ou attacher un patient », par le Docteur Guillaume
CHABRIDON, psychiatre hospitalier, CH Saint-Ylie-Jura/Dole et le docteur Nathalie GILOUX, Psychiatre
Hospitalier, Chef de Service, CH Le Vinatier, Bron,
11 CEDH, Glass c. RU, n°61827/00, §70.
12 CEDH, 3 juillet 2012, X c./ Finlande, n°34806/04, §§.214, 220.
13 CA Poitiers du 4 janvier 2018, N° de RG: 17/000686.
14 CA Caen du 27 mars 2017 N° de RG: 17/01030.